
En lice pour le Goncourt 2012, le romancier illumine cette rentrée avec un roman d’aventures moderne sur fond de révolutions arabes et de crise européenne. Questions à un amoureux du monde arabe, entre Paris, Barcelone et Tanger.
Révolution en Tunisie, guerre civile en Lybie, répression en Syrie : dix-huit mois après les événements de Sidi Bouzid en Tunisie, le « printemps arabe » continue d’enflammer toute une région et résonne jusque dans les romans de cette rentrée littéraire. Arabisant, familier de l’Afrique du Nord et de sa littérature, Mathias Énard en a fait le point de départ et le décor de son nouveau roman, Rue des voleurs : un vrai récit d’aventures « à l’ancienne », plein de rebondissements et de parallèles avec les crises politico-économiques qui frappent l’Europe depuis 2008. Le narrateur, Lakhdar, est un jeune marocain de Tanger qui erre entre mauvaises fréquentations (l’islamisme radical) et désirs de liberté (l’Espagne, les filles, les livres). Sous les auspices d’Ibn Battûta (l’intrépide explorateur tangérois du XIVème siècle) et de Mohamed Choukri (l’auteur du Pain nu), le romancier, natif de Niort, signe une fresque captivante, à cheval sur l’Orient et l’Occident, entre classicisme du ton et modernité des thèmes. Un roman qui pourrait bien remporter le prix Goncourt 2012 et qui valait bien quelques explications, recueillies au gré des incessants déplacements de cet écrivain-voyageur entre Paris, l’Espagne et la Méditerranée.
Quel est été le point de départ de l’écriture de ce roman ?
Rue des voleurs a commencé dans mon esprit au moment des révolutions tunisiennes et égyptiennes, que j’ai suivies de près à travers les médias. Mais il y avait longtemps que j’avais en projet d’écrire un « roman d’initiation », un roman de passage à l’âge adulte, un hommage aux romans d’aventures et au polar. Les deux idées se sont télescopées pour donner ce livre.
Avez-vous personnellement suivi les événements des printemps arabes ?
Bien sûr. Depuis de longues années, je suis très proche du monde arabe. J’y ai vécu longtemps, surtout à l’Est, en Syrie et au Liban, mais aussi en Égypte et à Tunis. J’ai donc suivi de près (mais de loin malheureusement, si vous me pardonnez le calembour) les révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye. Je n’y ai pas participé, bien évidemment, autrement qu’en envoyant des encouragements à des amis. Aujourd’hui, je suis avec horreur les évolutions de la situation syrienne en me demandant, jour après jour, ce que l’on peut faire.
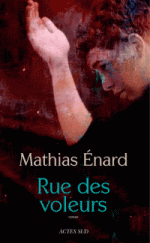
Vous faites parler votre héros, Lakhdar, à la première personne. Était-ce naturel pour vous ? Cela reflète tout de même une forme d’engagement de votre part…
C’est un des défis du livre. C’est d’abord une provocation, un engagement : un écrivain français « de souche » se met à la place d’un jeune Arabe, le fait parler à la première personne. J’ai longuement réfléchi à cette nouvelle « dépossession » d’un Arabe par l’Europe. C’est la question inverse qui m’a décidé à me lancer : que signifierait le refus (à cause de la distance, du respect) d’assumer la différence à la première personne ? Que voudrait dire le fait de ne pas pouvoir imaginer la vie d’un jeune Arabe aujourd’hui ? Ce serait restreindre absolument les possibilités de la fiction, ce serait admettre que je ne peux pas avoir de narrateurs allemands, arabes ou même femmes, par exemple, puisque je n’en suis pas une. C’est cette impossibilité de renoncer à cette liberté qui m’a fait continuer. Bien entendu, j’ai pris des précautions, Lakhdar a un destin exceptionnel, il ne représente pas les Arabes. C’est un personnage de fiction, une singularité, un accident du Destin et de la littérature. Un homme décalé. Même son prénom est décalé, comme il l’explique lui-même : c’est un prénom qui n’existe pas au Maroc. C’est le prénom d’un personnage de Kateb Yacine dans Nejma… Un personnage qui a un couteau. Sa langue elle-même n’appartient qu’à lui : un mélange de gouaille de polar des années 1950, d’arabe classique et des Mémoires de Casanova.
Pourquoi avoir fait commencer le roman à Tanger ? Est-ce une ville avec laquelle vous avez une familiarité particulière ?
J’ai choisi Tanger pour plusieurs raisons. Tout d’abord pour sa position géographique : c’est la limite nord-ouest du Monde Arabe, une ville-frontière, un point de vue complètement déplacé pour le monde arabe. Ensuite, Tanger, c’est une histoire littéraire, un mythe de la littérature européenne et américaine, une ville déracinée dans l’imaginaire, encore perdue littérairement dans la période internationale. C’est aussi la ville de Mohammad Choukri ou d’Angel Vázquez. C’est un excellent point de départ pour la fiction. C’est aussi une ville en pleine transformation, en passe de devenir une mégapole méditerranéenne, avec des investissements étrangers énormes, de nouvelles zones franches, etc. Un symbole de la transformation économique du monde arabe. Débuter le roman par Tanger, c’était, comme pour Lakhdar lui-même, déplacer le livre vers la fiction, donner au roman cette distance avec les événements que je ne pouvais pas avoir, que le temps ne me donnait pas.
Votre héros rencontre un personnage intrigant, islamiste à la fois protecteur et inquiétant, le Cheikh Nouredine. Vous a-t-il été inspiré par une personnalité en particulier ?
 Graffiti sur la place Tahrir en novembre 2011
Graffiti sur la place Tahrir en novembre 2011
Le personnage du Cheikh Nouredine est un de ceux qui m’ont le plus fasciné. Il est inspiré (comme Lakhdar lui-même) par plusieurs personnages réels. Il y a une véritable ambivalence dans l’islamisme politique, et principalement dans sa version salafiste : l’instrumentalisation de la fraternité. L’utilisation politique de l’action sociale. Nouredine est à la fois un père, un frère et un bâton. Il accueille généreusement Lakhdar, il semble tout sauf violent. On le retrouvera ensuite dans une fondation du Golfe, tout aussi ambiguë, capable de sponsoriser des équipes de football, des actions humanitaires et de la propagande. Les parcours de beaucoup de leurs membres passent, à un moment ou un autre, par l’action violente.
Des deux jeunes amis du début, l’un, Bassam, plonge dans le terrorisme l’autre, Lakhdar, pas. Qu’est-ce qui décide du basculement d’un jeune homme dans l’idéologie et le terrorisme ?
J’avoue que si j’avais la réponse, j’en serais bien aise. Malheureusement, ce n’est pas si simple. Qu’est-ce qui fait que certains de nos intellectuels, pourtant partageant la même formation la plupart du temps, choisissent, à 25 ans, de servir Vichy ou de s’envoler pour Londres ? On n’en sait rien. Là, le choix n’est pas collectif. Il est individuel, il se perd dans les méandres de l’individu. Bassam suit ce qui lui semble naturel. En un sens, il est fidèle à ceux avec qui il vit. Lakhdar, non. Il y a un accident du Destin qui l’emporte ailleurs. Une image de lui-même, une « pensée de derrière », comme dirait Pascal. Il n’est pas dupe. Le courage est toujours de savoir dire non, pas de suivre. Lakhdar fait preuve de plus de courage que Bassam, mais ce sont les circonstances qui lui en donnent les moyens.
 La police disperse les manifestants à Tanger le 01 juin 2011
La police disperse les manifestants à Tanger le 01 juin 2011
Il y a une ambivalence du rapport au livre chez vos personnages : le livre peut ouvrir l’esprit et libérer, mais aussi le livre qui peut communautariser et fanatiser…
Les livres sont à l’image de l’humanité, et au-delà du livre, le savoir. L’Europe a appris que la grande culture ne protégeait pas des œuvres de mort, que la connaissance n’était en aucun cas un rempart contre la violence. La violence politique se transmet aussi par les livres. Être un grand lecteur ne préjuge de rien. En revanche, je pense comme Saint Augustin : timeo hominem unius libri, je crains l’homme d’un seul livre. C’est par la pluralité, par l’exploration des différences et la multiplicité des expériences que l’on peut peut-être se prémunir contre la catastrophe.
Propos recueillis par Bernard Quiriny -
Source de l'article Evène
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire